Retrouver les logiques d'approvisionnement en ressources lithiques des populations passées constitue donc un des objectifs majeurs de la recherche, quasi aussi ancien que la discipline archéologique elle-même.
Au début des années 2000, une méthode d'inventaire et de caractérisation de ces ressources a été élaborée dans une perspective dynamique en s'appuyant sur le concept de « chaîne évolutive » et développée tant pour aider à des prospections harmonisées, que pour rendre cohérentes plusieurs dizaines de collections de références (nommée lithothèques) antérieurement constituées. L'objectif de cette méthode était (et est encore) de rendre compte de manière harmonisée, reproductible et explicite l'évolution des roches à plusieurs échelles d'observation et d'analyse.
Cette approche a fait l'objet de plusieurs travaux académique qui se sont largement appuyés sur le produit de projets Collectifs de Recherche (PCR), d'abord en Auvergne, en Lozère et en Ardèche, puis étendu à d'autres régions dans le cadre des « Réseau de lithothèques » (Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine, Ile-de-France, Occitanie, Antilles Française). Ces réseaux d'acteurs s'attachent depuis plusieurs années à partager des savoirs et savoir-faire et de transmettre au sein de la communauté un ensemble de protocoles, de méthodes, d'outils et de vocabulaire. Depuis 2019, ces PCR s'inscrivent dans une démarche à l'échelle nationale : le Groupe De Recherche (GDR) « SILEX », qui a été renouvelé en 2024 pour cinq ans. Soutenu par deux instituts du CNRS (Sciences humaines & sociales, Écologie & environnement), le ministère de la Culture, l'Inrap et les sociétés Paléotime et Eveha, ce projet fédère actuellement près de 80 chercheurs d'une quinzaine d'Unités Mixtes de Recherche (UMR).
Aujourd'hui, les travaux du GDR font l'objet d'une forte dynamique de partage à l'échelle nationale. Ils commencent à inspirer des chercheurs européens avec lesquels des liens sont établis en vue de futures collaborations. Ces réalisations démontrent comment il est possible de nouer ou renouer des relations de travail entre acteurs de la recherche autour des méthodes et techniques numériques ainsi qu'autour de conceptions communes et de protocoles partagés sur la caractérisation des silicites à plusieurs échelles d'observation. L'acquisition, le traitement, le partage et la publication de données en licence ouverte répondent à des enjeux non seulement de constitution de savoirs nativement numériques mais aussi de leur circulation instantanée dès leur production sur le terrain.
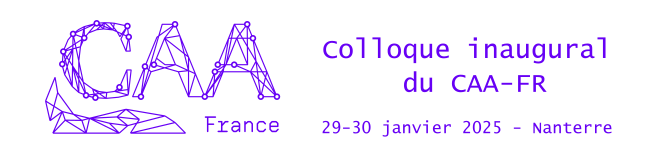
 PDF version
PDF version
